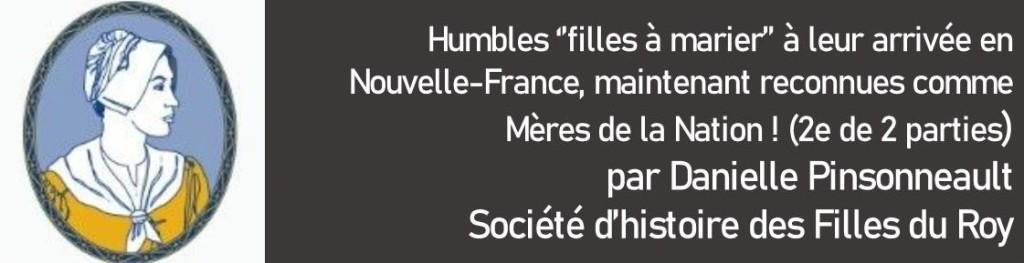Madame Danielle Pinsonneault de la Société d’histoire des Filles du Roy était notre conférencière invitée cette semaine pour nous offrir une conférence très animée et très appréciée sur le thème des Filles du Roy. Elle était accompagnée de Nathalie Lagassé. Pour ceux et celles qui n’ont pu assister à cette rencontre, Madame Pinsonneault a gentiment accepté de contribuer ce long article sur L’Entraide numérique qui contient l’essentiel de sa conférence. Nous vous présentons aujourd’hui la dernière de deux parties.
Un énorme merci à nos conférencières !

L’organisatrice principale de cette conférence à la SGCE – Rachel Lacombe (au centre) – présente nos deux conférencières de la Société d’histoire des Filles du Roy, Danielle Pinsonneault (à gauche) ainsi que Nathalie Lagassé (à droite), en costume d’époque et jouant le rôle d’une Fille du Roy. Plus d’une centaine de personnes étaient présentes ce mardi 26 septembre.
Cliquez ici pour débuter par la première partie de l’article si vous l’avez manquée hier.
Temps de lecture estimé – 18 minutes
*****
La traversée
La traversée de la grande mer était le premier grand défi à affronter. Même si ces femmes n’avaient jamais mis les pieds sur un navire, elles avaient entendu une foule de gens sur les quais en parler d’expérience. Par exemple à La Rochelle, on affirmait que « prendre la mer est plus dangereux que d’aller à la guerre. On a moins de chances d’en revenir! »[1] Les femmes connaissaient le risque qu’elles prenaient. Celles du premier contingent, en 1663, arrivèrent presque toutes sur l’Aigle d’Or. Le navire connut une de ses pires traversées ; il mit 111 jours à rejoindre Québec. Cela veut dire 3 mois, 3 semaines et 3 jours! Un voyage extrêmement long et pénible. On manqua d’eau et de nourriture, le scorbut se déclara. La promiscuité et le total manque d’hygiène entraîna la propagation de fièvres, de même que plusieurs maladies. Sur les 225 personnes à bord, soixante (60) moururent pendant le trajet et douze (12) autres après leur arrivée, même si, étendues sur des planches, on les transporta aussitôt à l’Hôpital de Québec. Cela signifie que près du quart des passagers de ce navire moururent avant de voir Québec. Pendant les longs mois de traversée, les conditions de vie étaient particulièrement pénibles. L’accès au pont était permis, mais seulement de jour et quand il faisait beau. Une femme ne pouvait jamais se promener seule, ni sur le pont ni ailleurs, elle devait toujours être accompagnée. Le confort et les commodités étaient réduits à leur plus simple expression. Dans la Sainte-Barbe, où logeaient les gens du commun, les femmes étaient installées d’un côté avec les enfants, les hommes de l’autre côté et les familles au centre. D’une hauteur d’une toise (1,94m= 6,4 pieds), la Sainte-Barbe était un lieu sombre où l’espace manque pour qu’on puisse se déplacer aisément. Quand le navire ne transportait pas de passagers, on y entassait les canons et les provisions pour se défendre. D’ailleurs, Sainte-Barbe est la patronne des canonniers.
Pour dormir, on attribuait aux gens des couchettes étroites et superposées où tous dormaient vêtus, souvent deux par lit. Certains navires disposaient de hamacs. Au fil des jours, les lieux devenaient malodorants ; l’humidité constante favorisait les moisissures. L’air salin rendait la peau poisseuse. On devait supporter les ronflements, les pleurs, les lamentations, ainsi que les borborygmes et les flatulences des uns et des autres. Les odeurs venant de l’étage d’en-dessous, où on entassait les animaux que le capitaine emmenait en Nouvelle-France (boeufs, vaches, cochons, volailles, pigeons et parfois des chevaux), rendaient la situation encore plus accablante.
Pour les besoins naturels des passagers, on trouvait deux seaux, un seau à chaque extrémité de la Sainte-Barbe. Un matelot les vidait à la mer quand la nécessité se faisait sentir. Il n’y avait pas d’eau pour se « débarbouiller » si on avait vomi. Lors des tempêtes, il fallait impérativement demeurer à l’intérieur, pendant des jours parfois. A la noirceur, parce que les écoutilles étaient bien fermées et qu’il n’était nullement question d’allumer une chandelle! S’il avait fallu que le feu prenne! On tentait de s’accrocher à un poteau, on tenait son enfant bien serré ou son coffre à « bras-le-corps ». Question nourriture, quand on avait vraiment faim(!), on mangeait du poisson séché, du poisson salé, des pois, des fèves et des biscuits de mer. Ces derniers étaient durs comme du bois et on devait d’abord les amollir dans un liquide pour les manger.
Il faut avouer que certains jours, l’appétit n’y était pas du tout. Outre les tempêtes qui donnaient mal au coeur, les émotions qui les habitaient, ennui, peur, colère, découragement, incertitude, rendaient souvent les gens taciturnes. Il restait la prière et les encouragements des personnes qui, ce jour-là, avaient encore le moral.
Quelles merveilles! Finalement, peu après l’Ile d’Orléans, les passagers ont enfin aperçu Québec. Le capitaine a jeté l’ancre en face de la petite agglomération. A ce moment-là, Québec comptait tout au plus 800 habitants.
Heureusement, toutes les traversées n’ont pas été aussi épuisantes, ni aussi longues. Généralement, la durée de la traversée vers la Nouvelle-France était d’environ deux mois et demi. Mais elle constituait toujours un sévère test d’endurance.
L’arrivée à Québec
Un beau jour, le navire est entré dans le golfe, puis dans le fleuve Saint-Laurent. Tout le monde à bord a retrouvé l’espoir. Les épaisses forêts, les montagnes, les rivières majestueuses qui se jetaient dans ce fleuve immense. Quelles merveilles! Finalement, peu après l’Ile d’Orléans, les passagers ont enfin aperçu Québec. Le capitaine a jeté l’ancre en face de la petite agglomération. A ce moment-là, Québec comptait tout au plus 800 habitants. Des barques se sont approchées en grand nombre. Il était évident que le navire et les personnes à bord étaient fébrilement attendus. Toutes et tous, mais surtout les « filles à marier » ont été accueillies par des personnalités du Conseil Souverain, le curé, Henri de Bernières, et madame de La Peltrie, la grande amie de Marie de l’Incarnation (les Ursulines étaient cloîtrées). Les gens sur la grève démontraient leur joie sans réserve. Bien des hommes reluquaient les filles, mais elles semblaient n’avoir qu’une envie, se délasser les jambes et monter chez les Ursulines. Enfin arrivées à bon port! Les années où elles seront très nombreuses, elles seront réparties également dans de bonnes familles, recommandées, comme celle de madame Anne Gasnier ou, dans certains cas, dans une famille apparentée.
Toutes ces personnes savaient combien la traversée constituait une lourde épreuve et dans quel état général les filles devaient se trouver. Aussitôt parvenues au lieu indiqué, on veillait à leur mieux-être : qu’elles puissent se laver, manger des fruits et des légumes à leur faim, dormir dans un bon lit, seule, revêtir des vêtements propres, regagner des forces.
Règle générale, les filles se mariaient dans les cinq (5) mois suivant leur arrivée. Certaines, après seulement 4 ou 5 semaines et d’autres, l’année suivante ou même 3 ou 4 ans plus tard.
Remises sur pied, commence la recherche d’un mari
Quand elles se sont refait une santé, on les informe des us et coutumes du pays et on leur donne des conseils sur les critères à retenir dans le choix de leur mari. Parce que le roi leur a vraiment promis qu’elles allaient pouvoir le choisir. Quelle chance! Marie de l’Incarnation leur disait de prendre leur temps, de ne pas prendre le premier venu, de s’informer, que celui qui a déjà sa terre et qui aurait déjà construit sa cabane pourrait être un meilleur parti… C’était assez souvent le cas, moyennant la promesse du colon de se marier dès que possible. Une fois le mari choisi, venait le moment de passer devant un notaire pour la rédaction du contrat de mariage. Toutefois, il arrivait assez souvent que l’une ou l’autre… change d’avis et demande au notaire de « déchirer le contrat ». Un bon nombre de femmes ont ainsi changé d’idée et sont repassées une deuxième fois devant le notaire. Certaines l’ont même fait une troisième fois! Le plus souvent, le notaire se déplaçait dans les maisons. Cette signature du contrat de mariage devant notaire était très populaire. Parmi les signatures des personnes présentes, on note souvent les noms du seigneur, de madame Gasnier, de membres du Conseil souverain ou de personnes influentes de l’endroit et même de l’intendant Talon à Québec, de Jeanne Mance ou de Maisonneuve à Montréal, avant son départ pour la France en 1665!
Le mariage
Une ou deux semaines plus tard, après la publication des bans, on célébrait le mariage religieux. Si la signature du contrat était l’occasion de réunir notables, dignitaires et un grand nombre de personnes, le mariage s’avérait une cérémonie toute simple, en famille, avec quelques amis peut-être.
Règle générale, les filles se mariaient dans les cinq (5) mois suivant leur arrivée. Certaines, après seulement 4 ou 5 semaines et d’autres, l’année suivante ou même 3 ou 4 ans plus tard. Par exemple, si, comme Catherine Moitié à Montréal, une fille avait signé un contrat de domestique d’une durée de quatre (4) années chez un employeur, elle ne pourrait quitter son travail avant l’échéance de son contrat, pour se marier.
Nous ne connaissons pas la personne qui en a décidé ainsi, ni le moment, ni le lieu, mais il est reconnu que les deux tiers des filles demeuraient à Québec et aux alentours, la région la plus populeuse. Ainsi, le tiers des filles devaient se rendre jusqu’à Trois-Rivières ou Montréal. Aussitôt que ces dernières s’en sentaient capables, elles faisaient leurs adieux. Elles avaient vécu de belles heures ensemble et des moments bien périlleux. Des liens très forts s’étaient noués entre plusieurs d’entre elles. Toutefois, il était très probable qu’elles ne se reverraient plus.
Des hommes de confiance allaient les conduire en canot ou en barque sur le Saint-Laurent, la seule route de l’époque. Les hommes pagayaient de jour seulement. Le soir, ils organisaient un campement de fortune sur une grève bien à l’abri. Tout le monde dormait sous les barques, en partie renversées, enroulé dans une couverture. Il fallait de deux à trois jours pour rallier Trois-Rivières, selon les caprices de la nature. Pour la dernière portion du voyage, le trajet se révélait un peu plus long à cause de la morphologie du fleuve. Ainsi, les campements de nuit étaient plus nombreux. Les hommes demeuraient constamment aux aguets à cause des Iroquois, nombreux dans cette région. A Trois-Rivières, petite bourgade de moins de 250 habitants en 1663, les quelques filles qui y ont débarqué étaient reçues et hébergées par le seigneur Pierre Boucher. A Montréal, c’était souvent Marguerite Bourgeoys en personne qui les accueillait et les hébergerait jusqu’à leur mariage.
La vie en Nouvelle-France
Près de 85% des filles ont épousé un habitant et vivaient sur une terre en « bois d’boutte ». L’intendant ou son remplaçant avait remis aux « filles à marier » des vêtements pour leur premier hiver, des provisions pour vivre jusqu’aux prochaines récoltes et de précieuses graines de semences de France pour leur potager de l’été suivant.
Dans la première année, l’installation sur une pareille terre constituait une rude entreprise, surtout si le jeune couple venait à peine de se voir concéder une terre. Généralement, la terre mesurait 3 arpents en largeur par 30 en profondeur. Chacune donnait sur le fleuve. Si le couple s’était marié en octobre ou novembre, comme cela arrivait souvent, le temps leur était compté avant que les neiges commencent à tomber. Il fallait s’y mettre prestement.
Louise Dechêne explique : « Sa première tâche est d’abattre ce qu’il faut d’arbres pour construire une cabane de pieux d’environ quinze pieds sur vingt, de petits arbres qu’il aiguise à un bout et plante en terre. C’est une construction assez frustre sans plancher ni cheminée, mais qu’il faut rendre suffisamment étanche pour y passer au moins un hiver. Il utilise des écorces et des herbes (chaume) pour faire le toit et boucher les fentes. Au bout de trois à quatre semaines, il peut apporter son coffre et ses provisions dans cette cabane, quitte à la parfaire avant l’hiver »[2]. Cela signifie entre autres, installer une porte, tailler une fenêtre et y poser un papier parchemin huilé qui tiendra lieu de vitres (hors de prix), et ce, du côté opposé au vent dominant; construire un âtre en pierres et sa cheminée. Ce sera une habitation temporaire, sur terre battue, mais qui devra abriter la famille souvent pendant plusieurs années. La priorité étant «d’abattre le bois debout, arracher les souches, petites ou de grandeur moyenne, brûler les branchages, épierrer le terrain. Travail lent : il faut un an à un colon seul pour défricher et rendre propre à la culture une superficie d’un arpent et demi, et encore il faudra travailler parmi de grosses souches qu’il faut laisser pourrir avant de les enlever »[3].
Un pays neuf et si vaste
Tous ceux et celles qui arrivaient en Nouvelle-France étaient sidérés de découvrir un monde où tout était si vaste : le golfe, le fleuve, les forêts, les distances entre les lieux habités, les lacs, etc. Tout était tellement différent. Rapidement, ils ont constaté les quatre saisons bien marquées, dont un hiver rigoureux de 6 mois, ce qui implique l’obligation d’apprendre à travailler selon le rythme des saisons, si distinctes l’une de l’autre. Ils ont aussi remarqué la présence des Amérindiens, la dispersion des maisons, l’absence de routes, le manque de boeufs de trait et d’outils pour le gros oeuvre. Tous, mais surtout les gens du commun je crois, ont vite compris qu’ils auraient à s’adapter, à s’acclimater! Il y avait tellement à apprendre. Avant tout, il faudrait penser aux besoins primaires!
L’urgence : » apprendre l’hiver ». Savoir adapter sa maison, ses vêtements, sa façon de chauffer la maison, penser à s’approvisionner de bois de chauffage pour les 6 mois d’hiver, apprendre à se déplacer sur la neige en raquettes et en toboggan. Apprendre à chasser, à trapper, à pêcher, à manger des poissons inconnus, du gibier, à trouver des moyens de conservation des aliments et à fabriquer des outils au besoin.
Au printemps, il leur faudra mettre les animaux au pacage et préparer la terre pour les semailles, profiter du passage des oies, des outardes et des canards, apprendre à semer la citrouille, les haricots et le maïs, de même que les multiples utilités du bouleau. A l’été, ils devront ramasser les fourrages, engranger l’orge et l’avoine, récolter les pois, couper le blé, battre le grain, faire moudre le blé au moulin.
À l’automne, fumer la terre, récolter les légumes du potager. Ramasser les inestimables graines des légumes dont on aura besoin au printemps prochain. Renchausser la cabane, insérer fermement de l’étoupe dans toutes les fentes des murs. Mettre les betteraves, carottes, navets, rutabagas et choux au frais, sur des branches de sapin sous la maison. Faire boucherie. Faire son boudin. Faire du savon. Refaire les paillasses avec de la paille fraîche. Préparer ses teintures végétales. Et ainsi de suite.
Il faudra compter 5 ou souvent 10 ans de travail soutenu pour qu’une terre fournisse le minimum vital pour faire vivre une famille.
« À sa mort, 30 ans après avoir reçu sa concession (sa terre), l’habitant possède 30 arpents de terre arable, une pièce de prairie, une grange, une étable, une maison un peu plus spacieuse, un chemin devant sa porte, des voisins, un banc à l’église. Sa vie a passé à défricher, à bâtir. »[4]
Un pays apprivoisé
Les habitants avaient eu beaucoup à apprendre, à apprivoiser. Ils y ont mis du coeur. Ils ont réussi. Ils ont eu un précieux support des Amérindiens pour apprendre à chasser et pêcher, pour conserver la nourriture au fil des saisons, pour apprendre comment travailler la fourrure pour que les vêtements protègent mieux du froid, pour marcher sur la neige, pour transporter les lourdes charges en hiver, pour découvrir les vertus d’un grand nombre de plantes médicinales et comment les utiliser pour guérir.
Plusieurs se sont mis à l’apprentissage des langues amérindiennes, ont apprécié la vie que menaient les Amérindiens, leurs rapports chaleureux avec les enfants, leur indépendance, leurs liens avec la nature. Combien de témoignages insistent sur l’influence marquante qu’ils ont eue sur les mentalités.[5] Marie de l’Incarnation disait « qu’il était plus facile de faire des Sauvages avec les Français que l’inverse ». Comme Champlain, Jeanne Mance et le Sieur de Maisonneuve, elle avait rêvé de l’inverse justement.
De même, ils ont rapidement compris qu’il leur fallait une langue commune, eux qui avaient des parlers régionaux considérablement différents. Dans la maison, c’est la mère qui joue le plus grand rôle dans la transmission de la langue parlée. Or, comme les mères venaient majoritairement de l’Ile-de-France et de quelques autres provinces proches de Paris, où tout le monde ou presque était devenu familier avec le français, c’est le français qui s’est vite généralisé et est devenu la langue commune. D’autant plus que c’était la langue du pouvoir, celle des militaires et celle des autorités tant civiles que religieuses.
Elles étaient arrivées de France avec la mission de peupler la Nouvelle-France. Elles ont tenu parole! « Elles ont enfanté à coeur de vie ». Elles « nous ont mis au monde et tout le pays avec nous »!
Les habitants ont appris à briser l’isolement, à tisser des liens avec les voisins, même s’ils étaient éloignés, à se constituer un réseau social. Ils ont appris à développer leur autonomie, à faire du troc et ensemble, à devenir autosuffisants.
Au travers de cette vie laborieuse…
Au travers de toutes ces besognes, les femmes ont mis au monde les enfants, les ont allaités, les ont soignés, ont fait le pain, sont allées chercher l’eau à la rivière, ont fabriqué des chandelles, ont tricoté, ont rapiécé et ont nourri la famille. Elles ont aussi enseigné aux enfants puisque l’école était inexistante, sauf à Québec et Montréal et encore, pas accessible à tous.
Les sage-femmes étaient fort peu nombreuses à l’époque. Les femmes ont donc accouché seules ou avec l’aide d’une voisine, la plupart du temps. Elles ont eu des familles nombreuses. Elles ont perdu plusieurs enfants malgré leurs soins attentifs. Et trop d’entre elles (5% des Filles du Roy) sont mortes en donnant la vie. Souvent à la naissance du premier enfant ou du dernier, alors que le corps est épuisé d’avoir tant donné la vie!
Conclusion
Elles ont trimé dur. Elles ont vécu courageusement, avec force et générosité. Avec amour! Elles étaient arrivées de France avec la mission de peupler la Nouvelle-France. Elles ont tenu parole! « Elles ont enfanté à coeur de vie ». Elles « nous ont mis au monde et tout le pays avec nous »![6]
Elles nous ont donné tout ce qu’elles portaient en elles : leur culture, leurs coutumes, leur croyance, leur langue, cette « langue belle », leurs valeurs, leur savoir-faire. Un legs inestimable! Elles sont les Mères de la nation québécoise!
Nous les portons en nous ces femmes, que nous le sachions ou non. Il est grand temps de parler d’elles. De les célébrer! Avec fierté!
Grâce à elles, parmi les quelques grandes villes d’Amérique du Nord, telles New-York, Boston et Philadelphie, qui peuvent se vanter de compter près de 400 ans d’histoire, Montréal est la seule ville d’origine française et toujours de langue française.

[1] Sur un petit pilier au dernier étage du clocher de la chapelle Bonsecours attenante au Musée Marguerite Bourgeoys dans le Vieux Montréal, qui surplombe une partie du port de Montréal, on peut lire cette inscription : « Si tu vas à la guerre, prie une fois, si tu prends la mer, prie deux fois».
[2] Dechêne Louise, Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle, Montréal, 1998, p.271
[3] Trudel Marcel, Mythes et réalités dans l’histoire du Québec, BQ, 2010, p.98
[4] Dechêne, Louise, Habitants et marchands à Montréal au XVIIe siècle, Montréal, 1998, p.272
[5] Mathieu Jacques, La Nouvelle-France, Les Français en Amérique du Nord, XVIe-XVIIIe siècle, P.U.L., 2001
[6] Hébert Anne, Le premier jardin, 1988
*****
Cliquez ici pour retourner à la page d’accueil du site pour lire ou relire d’autres articles.