Cet article, publié dans la revue L’entraide généalogique (2012, Vol. 35-3) sous la plume de Jean-Claude Fontaine (#352) s’est mérité le prix Raymond-Lambert du meilleur article de 2012, ex-aequo. Il illustrera l’étonnante répétition durant plusieurs générations de traits de personnalité, de professions exercées et aussi de tragédies vécues par les familles de Joseph Papineau, de Louis-Joseph Papineau, de Napoléon Bourassa et d’Henri Bourassa.
La majorité des gens connait l’expression « ça ne prend pas la tête à Papineau » qui signifie «ça ne requiert pas une grande intelligence». Louis-Joseph Papineau a joué un rôle central dans la révolte des Patriotes en 1837, il en était le leader et l’âme dirigeante. Il faut remonter à son père, Joseph Papineau et à la grand-mère de Joseph, Catherine Quevillon, pour retrouver les traits de personnalité caractéristiques.
Temps de lecture estimé – 23 minutes
*****
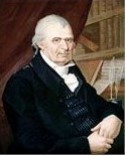
Joseph Papineau (1752-1841) (Reproduction sur plaque de verre d’un tableau réalisé par Louis Dulongpré vers 1820)
Joseph Papineau (1752-1841) naît le 16 octobre 1752 à Montréal et est baptisé à la paroisse Notre-Dame. Il fait partie de la troisième génération à demeurer en Nouvelle-France. Joseph est le petit-fils d’un premier Papineau à vivre en Nouvelle-France, Samuel Papineau et sa femme Catherine Quevillon. Joseph a la stature, la robustesse, le franc-parler et l’énergie de sa grand-mère Catherine. Il se marie à Rosalie Cherrier le 23 août 1779 à Montréal. Ils auront neuf enfants dont quatre décèdent en bas âge. Ceux qui ont atteint l’âge adulte sont : Louis-Joseph Papineau (1786-1871) qui a eu une carrière politique importante, Rosalie (1788-1857), Denis-Benjamin (1789-1854), agent seigneurial, marchand, éleveur, député important sous l’Acte d’Union, Augustin Papineau (1790-1876) qui est notaire et Toussaint-Victor (1798-1869) qui est prêtre.
Après avoir complété ses études classiques, Joseph devient bachelier ès arts en 1771. Il s’initie à l’arpentage et reçoit sa commission d’arpenteur en 1773. Il débute un stage de clerc en notariat en 1775 et obtient sa commission de notaire en 1780. Il pratiquera cette profession pendant 61 ans. Son travail d’agent seigneurial à la seigneurie de la Petite-Nation (Montebello) pour le Séminaire de Québec l’amène à en devenir le propriétaire pour la revendre à son fils Benjamin en 1816 et à son fils Louis-Joseph en 1817.
De façon imprévue, la vie politique rejoint ce jeune notable. Pendant l’invasion américaine de 1775-1776, il prend part à la défense de la colonie. Ensuite, il met toute l’influence dont il jouissait à convaincre ses compatriotes de revendiquer pour les Canadiens-Français les mêmes droits politiques que les sujets britanniques.
Suite à l’Acte constitutionnel de 1791, le Haut-Canada et le Bas-Canada ont chacun une Chambre d’assemblée octroyant les mêmes droits politiques aux Canadiens-Français comme aux sujets britanniques. Cette loi oblige le gouverneur à créer dans chacun des deux Canadas une chambre d’assemblée formée d’élus, notamment pour voter la levée des impôts afin de pourvoir aux dépenses administratives civiles et judiciaires de la colonie. Cependant, le gouverneur conserve un pouvoir arbitraire puisqu’il peut, avec le Conseil législatif (composé d’une majorité d’anglophones dont les membres sont nommés à vie par le gouverneur) faire indéfiniment échec à la Chambre d’Assemblée.
Lors des premières élections qui ont lieu en juin 1792, Joseph Papineau est élu dans le comté de Montréal. Il réagit fortement lorsqu’au premier jour de la session, les sujets britanniques proposent l’abolition de la langue française lors des débats de la Chambre et l’attribution de la présidence. La Chambre d’Assemblée statue après trois jours que les procès-verbaux seront rédigés dans les deux langues et un Canadien-Français est nommé président de la Chambre.
Joseph siégea jusqu’en 1804. Mais en 1809, le Parti canadien le força à un retour à la vie politique pour aller porter secours aux membres de la Chambre d’Assemblée. II est sollicité pour son éloquence et son patriotisme pour aller affronter le gouverneur Craig. Joseph Papineau décède à l’âge de 88 ans et huit mois le 8 juillet 1841 à Montréal. L’avenue Papineau de Montréal a été nommé en son honneur en 1890 par le Conseil municipal de Montréal.
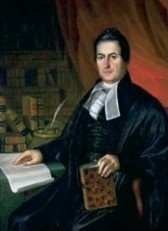
Louis-Joseph Papineau (Tableau réalisé par Antoine Plamondon vers 1836)
Son fils aîné, Louis-Joseph est celui qui sera le plus connu. Louis-Joseph a hérité de plusieurs qualités de son père, Joseph Papineau. Il est spécialement un très bon orateur et comme son père, un ardent défenseur des droits des Canadiens-Français. Il jouera un rôle important dans la révolte des Patriotes en 1837 dont il est l’âme dirigeante.
Louis-Joseph commence ses études classiques au Collège St-Raphaël de Montréal et les poursuit en 1802, au Petit séminaire de Québec. Il fait sa cléricature en droit chez son cousin Denis-Benjamin Viger et est reçu avocat à l’âge de 23 ans. Il exercera cette profession sporadiquement car sa vie politique débute tôt et de façon très accaparante. Il fait partie de la seconde génération d’hommes publics canadiens. Il a seulement 21 ans lorsqu’il devient en 1808 le député de comté de Kent (Chambly) à la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada. En 1814, il est réélu mais dans le comté de Montréal-Ouest et il sera réélu plusieurs fois dans ce comté qu’il représente jusqu’en 1837.
En 1815, Louis-Joseph est alors âgé de 29 ans seulement mais déjà son éloquence, sa confiance en lui et sa popularité lui permettent de s’illustrer dans le groupe des jeunes nationalistes et il devient le chef du Parti canadien. Ce parti promeut la responsabilité ministérielle (désigne la redevabilité du gouvernement envers les élus et non envers le gouverneur), la fin du favoritisme et plus de pouvoir aux gens élus par le peuple. Ce parti devient le Parti des patriotes en 1826.
En 1815, Louis-Joseph est choisi par les députés pour être nommé orateur (président) de la Chambre-basse du Bas-Canada (l’Assemblée législative). Il reçoit annuellement une généreuse rétribution de 1 000 livres (4 000 $). Il occupera cette fonction pendant plus de 20 ans, jusqu’à la Révolte des patriotes en 1837. Il est un orateur doué, adoré par les foules et il ne manque jamais une occasion de protester contre les abus du gouverneur et ses amis, les membres non élus désignés de la Chambre-haute (Conseil législatif) qui rejettent souvent, selon Papineau, les décisions de l’Assemblée législative.
En 1823, il est choisi avec John Neilson par les députés pour se rendre en Angleterre afin de s’opposer vivement au projet d’union du Haut et du Bas-Canada annoncé en 1822. Ils y passent près d’un an et obtiendront de Londres l’abandon de ce projet fomenté par le gouverneur et sa clique.
Dans les années 1830, Louis-Joseph intensifie ses virulentes attaques à l’endroit du Conseil législatif non élu et de l’autoritarisme du gouverneur.

Portrait de Louis-Joseph Papineau, à l’âge de 72 ans, à sa seigneurie de Montebello, en 1858 peint par Napoléon Bourassa, son gendre.
En 1834, c’est l’écrasante victoire électorale, l’accentuation du boycottage d’importations de produits anglais qui avait été proposé par Papineau et l’obstruction politique afin d’arracher des réformes de Londres. Louis-Joseph augmente son prestige en faisant adopter les Quatre-vingt-douze résolutions, une liste de revendications politiques des Canadiens-Français rédigée par un petit comité qualifié de radicaux. Ces résolutions demandaient entre autres l’élection du Conseil législatif, la responsabilité ministérielle et le contrôle du budget par l’Assemblée. Londres rejette catégoriquement ces revendications par les dix résolutions de Russell soumises à la Chambre d’assemblée du Bas-Canada le 6 mars 1837.
Le lundi 23 octobre 1837, à St-Charles-sur-le-Richelieu, Louis-Joseph Papineau adresse la parole à quelque 4 000 concitoyens enflammés, dans l’un des six comtés où des patriotes ont plus ou moins déclaré l’indépendance politique et décidé de recourir aux armes, au besoin.
Le 23 novembre 1837, le soir de la bataille de St-Denis-sur-le-Richelieu, la première grande bataille et la seule victoire des Patriotes, n’ayant pu calmer les esprits qu’il avait contribué à réchauffer, Louis-Joseph Papineau décide de s’enfuir aux États-Unis afin d’obtenir de l’aide. Il se réfugie successivement au Vermont, à New York, puis à Paris avec sa femme et trois de ses enfants.
Le mercredi 29 novembre 1837, sa tête est mise à prix pour 4 000 $, alors le prix de 400 peaux de loup, par proclamation du gouverneur, Lord Gosford, pour « haute trahison ».
Pendant son exil à Paris qui dura de mars 1839 à octobre 1845, Louis-Joseph continue de s’opposer à l’Acte d’Union des deux Canadas, promulgué en 1841 suite au rapport Durham paru en 1839.
Louis-Joseph revient au Canada au printemps de 1846 après un exil de huit ans, la situation politique s’étant calmée depuis quelques années et le gouverneur l’ayant amnistié. Il revient à la vie politique en janvier 1848 sous le Parti rouge dans le comté de St-Maurice, mais continue de s’opposer à l’union des deux Canadas. Ce parti rallie seulement une minorité de Canadiens-Français. Son libéralisme et son anticléricalisme effraient le clergé catholique.
Louis-Joseph Papineau se présente en 1852 dans le comté de Deux-Montagnes. Mais il se sent dépassé par les évènements et la nouvelle situation, si différente. Il est ignoré par les nouveaux dirigeants politiques et par le clergé. Il ne retrouve plus tout son prestige d’autrefois. Il n’approuve pas la modération des nouveaux leaders politiques qui sont ses anciens partisans, tels que Louis-Hippolyte Lafontaine, Georges-Étienne Cartier, devenus des réformistes modérés qui s’accommodent de l’actuelle union des deux Canadas. Ces derniers obtiennent en 1848 l’usage du français interdit depuis l’Acte d’Union de 1841, et l’établissement de la responsabilité ministérielle. Le Conseil exécutif (Cabinet) devient désormais dépendant du vote majoritaire de l’Assemblée législative. Louis-Joseph s’aperçoit aussi qu’il s’est attiré l’hostilité générale du clergé. Il abandonnera la vie politique en 1854 et décide d’aller vivre dans sa seigneurie.
Il reçoit à la mi-juin 1846, ses arrérages de rétribution comme orateur de la Chambre, ce qui lui permettra de faire construire dans sa seigneurie de la Petite-Nation, un superbe manoir à Montebello. En 1854, une loi liquidant le régime seigneurial est adoptée. Il recevra en compensation la somme fabuleuse de 89 000 $ comptant.
Louis-Joseph Papineau savait faire preuve d’éloquence pour rejoindre le peuple. Il vit à une époque où l’engouement pour les discours politiques ou patriotiques est remarquable. Il est l’une des grandes figures de la première moitié du 19e siècle.
Il s’était marié à l’âge de 31 ans le 29 avril 1818 dans la ville de Québec avec Julie Bruneau (1795-1862), alors âgée de 23 ans. Neuf enfants naîtront mais seulement cinq atteindront l’âge adulte. Avec sa femme, il traversera plusieurs périodes difficiles en raison de la maladie de plusieurs de ses enfants. Quatre d’entre eux décèdent à l’âge de trois ans ou moins. Gustave décédera à l’âge de 22 ans (1829-1851). Azélie décédera à l’âge de 34 ans (1834-1869) laissant cinq enfants seuls avec leur père, Napoléon Bourassa. Lactance décédera prématurément à l’âge de 40 ans (1822-1862) après plusieurs années de maladie mentale. Ézilda (1828-1894) souffrant de nanisme décédera à 65 ans. L’ainé de la famille, Amédée, décédera à 84 ans (1819-1903). Seulement Amédée et Azélie auront une descendance.
Louis-Joseph Papineau décédera le 23 septembre 1871 à l’âge de 84 ans et 11 mois dans son manoir de Montebello. À sa demande, ses funérailles ont été totalement civiques sans aucun contenu religieux. Julie Bruneau Papineau a toujours soutenu son époux dans son combat politique. Elle décédera à l’âge de 67 ans au manoir Montebello le 18 août 1862.
Amédée est notaire, avocat et protonotaire. Il se marie à 27 ans avec une Américaine, Mary Eleanor Westcott et ils auront quatre enfants. Veuf à 71 ans, il se remarie à 78 ans le 18 avril 1896, avec Martha Jane Iona Curren, alors âgée de 24 ans et qui travaillait au Manoir de Montebello. Deux enfants naissent de cette union, Lafayette (5 février 1897) et Amgelita Iona (10 août 1901) alors qu’Amédée est âgé de 82 ans. Amédée décède à 84 ans en novembre 1903 alors que pendant l’été précédent, il se promenait dans les bois de Montebello avec un carrosse à bébé.

Autoportrait de Napoléon Bourassa vers 1860
Azélie se marie le 17 septembre 1857 à 23 ans avec Napoléon Bourassa qui deviendra l’un des artistes canadiens les plus renommés du 19e siècle et un écrivain. Ils auront cinq enfants. Cet artiste créateur restera dans l’ombre de son beau-père Louis-Joseph Papineau, de son fils Henri, grand défenseur des Canadiens-Français et fondateur du journal Le Devoir. L’ambition et les aspirations de Napoléon Bourassa ne concordaient pas avec l’esprit du 19e siècle, qui marginalise ceux qui sont hors-norme. D’ailleurs, Louis-Joseph Papineau s’oppose fortement au mariage de sa fille Azélie à cet artiste.
Napoléon Bourassa a peint des paysages, des scènes et des portraits. Il est l’auteur du fameux portrait de Louis-Joseph Papineau, à l’âge de 72 ans, dans sa seigneurie de Montebello en 1858.
Napoléon Bourassa, né le 27 octobre 1827, meurt à l’âge de 89 ans le 27 août 1916 à Lachenaie, soit près de 40 ans après son épouse Azélie décédée prématurément le 27 mars 1869 à l’âge de 35 ans.
L’œuvre imposante de Napoléon Bourassa a fait l’objet d’une grande exposition en 2011 au Musée national des beaux-arts du Québec, à Québec. Cette exposition a permis de reconnaître après 100 ans d’oubli l’importance de ce peintre, dessinateur, architecte, sculpteur reconnu enfin comme un monument de notre histoire artistique.
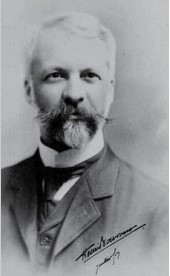
Henri Bourassa, en 1917, à l’époque où il mène l’opposition canadienne française à la conscription
Le dernier des enfants de Napoléon Bourassa s’appelle Henri et naît à Montréal le 1er septembre 1868. Il est âgé d’un an seulement lorsque sa mère Azélie Papineau décède prématurément. Napoléon étant pris avec cinq jeunes enfants et devant être régulièrement absent en raison de son travail, Ézilda, sœur d’Azélie, viendra habiter chez lui pour prendre charge de la famille et libérer son beau-frère des corvées familiales. Henri sera beaucoup influencé par sa tante Ézilda inlassablement dévouée qui lui inculque une foi et des valeurs religieuses catholiques. Il dira un jour de sa tante naine de trois pieds quatre pouces, qu’elle menait la maisonnée au bout de la baguette.
Henri Bourassa a passé les premières années de sa vie à Montréal et il étudie principalement sous la direction de précepteurs privés plutôt que dans des collèges privés. Il a développé un mode de pensée indépendante et critique différente des notables de son époque dont la pensée était moulée sur celle enseignée dans les grands collèges. Il déménage à Montebello à l’âge de 18 ans et emploie son temps à l’agriculture. Vraisemblablement, il a hérité de la passion et des talents de son grand-père, Louis-Joseph Papineau. À l’âge de 21 ans, Louis-Joseph Papineau devient député du comté de Kent alors qu’Henri débute aussi sa vie politique à 21 ans en prenant la charge de maire de la municipalité de Montebello (1889-1894) et il devient un peu plus tard le premier maire de la municipalité voisine de Papineauville (1896-1904).
Henri Bourassa devient député du Parti libéral du Canada à la Chambre des Communes dans le comté de Labelle (1896-1899) et il démissionne en 1899 pour protester contre la décision de Wilfrid Laurier d’envoyer un contingent militaire canadien pour participer à la guerre des Boers sans avoir consulté préalablement la Chambre des Communes. Selon l’historien Robert Rumilly, cet événement a été capital pour sa carrière politique. En 1908, il se présente sous la bannière de la Ligue nationaliste dans le comté de Montréal-2 (1908-1909) et vainc le Premier ministre libéral du Québec, Lomer Gouin.
En 1905, à l’âge de 37 ans, il se marie avec Joséphine Papineau fille du notaire Godfroy Papineau, alors âgée de 27 ans. Le 10 janvier 1910, il fonde le journal Le Devoir. Il en sera le rédacteur en chef jusqu’en 1932. Son épouse décède en 1919, lui laissant huit enfants âgés de un à douze ans.
En 1925, puisqu’il est un peu lassé du journalisme, il décide d’effectuer un retour à la vie politique. Il est élu député indépendant dans le comté de Labelle à la Chambre des Communes (1925-1935).
Suivant les traces de son grand-père, Louis-Joseph Papineau, qui avait mené à l’insurrection armée en 1837, Henri Bourassa avait aussi l’intention de défendre les droits et réclamations du Québec. Il était un politicien combatif qui a passé sa vie à lutter pour les droits des Canadiens-Français et à défendre leurs intérêts. Dans un article du 16 septembre 1993, Lise Bissonnette alors directrice du Devoir, écrit que Henri Bourassa était préoccupé de justice sociale et d’assainissement des mœurs politiques. Elle ajoute qu’Henri Bourassa valorisait avant tout son indépendance d’esprit. Il a été en politique pour défendre des principes et des idées. Ses contemporains préféraient en lui le tribun, qui survoltait les foules et électrisait la jeunesse.
Les similitudes entre Henri Bourassa et Louis-Joseph Papineau sont qu’ils étaient des hommes de principes, qui ont sacrifié des amitiés pour défendre des idéaux et des valeurs. À l’instar de son grand-père Louis-Joseph et de son arrière-grand-père Joseph Papineau, Henri est un défenseur des droits des Canadiens-Français. Pendant plus de quarante ans, il est l’une des figures de premier plan dans la plupart des luttes politiques au Canada.
Il se faisait une ligne de conduite farouche d’agir avec conscience et intégrité. Il détestait le déni du droit et de la justice et l’abus de la force. Afin que les amitiés durent, ses camarades devaient être en accord avec ses idéaux. Son indépendance financière lui permettait de n’être à la merci de personne. Sur le plan politique, il ne croyait pas à un Québec indépendant mais plutôt à un Canada où les deux races vivent avec harmonie. Par contre, il n’a pas hésité à appuyer le Bloc Populaire lors de la Deuxième guerre mondiale afin de contrer la décision d’obliger les Canadiens-Français à aller au combat. Même s’il a été en politique provinciale et fédérale pendant 24 années, il n’a jamais occupé un poste de ministre ou le poste de Premier ministre. Il a été un homme de principes et non un homme d’action.

Anne Bourassa, fille aînée de Henri Bourassa à l’’émission Aujourd’hui, Radio-Canada, 2 septembre 1968.
Sa fille Anne nous rappelle dans le documentaire présenté à Radio Canada en 1968, que son père a décidé de se consacrer au journal Le Devoir, une œuvre qu’il jugeait plus utile que la vie publique. Henri Bourassa était d’avis qu’en formant l’opinion publique par le travail journalistique et les discours, il contribuait à relever les mœurs politiques. Pour lui, les mœurs politiques passent par l’opinion publique qui inspire les partis politiques. Henri Bourassa a vécu à une époque où les discours politiques étaient courants et très appréciés par le peuple. Il était un grand orateur qui savait rejoindre le peuple par le cœur et la pensée.
Sur le plan religieux, Henri Bourassa était cependant aux antipodes de son grandpère Louis-Joseph Papineau. Ce dernier est anticlérical et athée alors qu’Henri Bourassa est profondément religieux, un catholique ultramontain et presque un moine laïc. Sa maison était remplie d’objets religieux et ressemblait presque à un monastère selon l’historien Robert Rumilly. Ses pratiques de dévotions sont devenues plus intenses et fréquentes après la fin de sa vie politique selon sa fille Anne.
Henri Bourassa est décédé le 31 août 1952 à sa résidence d’Outremont à l’âge de 83 ans et 11 mois et il a été inhumé à Montréal, dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le 4 septembre 1952. Des huit enfants qu’il a eus avec Joséphine Papineau, seul son fils Jean a eu une descendance. Jean est décédé à Sherbrooke en 1978. L’aînée, Anne est décédée à 97 ans en 2003 à Outremont. Son avis de décès précise qu’elle a contribué à garder vivant le souvenir de son père Henri et à faire connaître le talent de son grand-père Napoléon Bourassa, peintre et architecte. Le dernier des enfants de Henri Bourassa encore vivant en 2003, Bernard Bourassa, père jésuite est décédé le 30 juillet 2009 à Fortaleza au Brésil.
Sources et documentation consultée :
CARDINAL, Mario. Pourquoi, j’ai fondé Le Devoir – Henri Bourassa et son temps, Montréal Libre Expression, 2010, 396 p.
LAMARCHE, Jacques. Les enfants Papineau, Lidec inc., 1998, 59 p.
LACOURSIÈRE, Jacques, Jean PROVENCHER et Denis VAUGEOIS, Canada-Québec 1534-2000, Sillery, Septentrion, 2000, 584 p. LACHANCE, Micheline. Le roman de Julie Papineau La Tourmente, Montréal, Éditions Québec/Amérique, 1995-1998.
LACHANCE, Micheline. Le roman de Julie Papineau L’exil, Montréal, Éditions Québec/Amérique, 1998.
Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos jours.
Site WEB de l’Assemblée nationale.
Site WEB de « La Mémoire du Québec ».
À la découverte d’une des familles les plus illustres du Québec.
Site WEB de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Portail de La Petite-nation.
Portail de ‘’les Projets Da-Go’’.
BISSONNETTE, Lise. Un défenseur passionné. De l’idée, Le Devoir, 16 septembre 1993
MICHEL, Gréco. Portrait de Henri Bourassa, à l’émission Aujourd’hui, Radio-Canada, 2 septembre 1968, 19 minutes. [Invités : Anne Bourassa, Michel Brunet, Lionel Groulx, André Laurendeau, Robert Rumilly, Paul Sauriol.]
*****
Cliquez ici pour retourner à la page d’accueil du site pour lire ou relire d’autres articles.
__________
L’Entraide numérique est un site Web de publication d’articles publié par la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est (SGCE) ayant pour objectif le partage des connaissances de nos membres. Il se veut un complément à notre revue L’Entraide généalogique. Ce site Web publie trois fois par semaine, soit les lundis, mercredis et vendredis, sur des sujets liés à la généalogie, à l’histoire ou au patrimoine québécois. Le site est ouvert à tous, membres et non-membres de la SGCE. On peut s’y abonner sur la page d’accueil du site et ainsi recevoir une infolettre qui vous envoie l’intégralité de chaque article dès sa publication.






Laisser un commentaire