L’article suivant a été publié dans la revue L’entraide généalogique en 2019, édition d’automne. Il a été écrit par Olivier Berger. L’auteur revient sur le phénomène des religieuses dans l’histoire et l’évolution du Québec, plus particulièrement au 19e et au 20e siècle.
Temps de lecture estimé – 14 minutes
*****
LES RELIGIEUSES AU QUÉBEC, ENTRE AVANCEMENT SOCIAL ET CONSERVATISME

Noces d’or de Wilfrid Berger et Aurore Desautels – Juillet 1967 – Devant : Angèle (Oblate de Marie-Immaculée), Abbé Conrad, Wilfrid, Aurore Desautels, Sœur Jeannette (Sœur Ste-Jeanne-Marie, s.s.ch.) et Sœur Suzanne (Sœur Ste-Yolande, s.s.ch.) Derrière : Fernand, Yvon, Yolande, Anita, Origène, Bernadette, Flore-Anna, Léonide et Gérald. © Fonds d’archives Aurore Desautels – Olivier Berger [Auteur inconnu].
Des changements politiques et sociaux dans les années 1840
Le début du XIXe siècle est, dans l’histoire nationale québécoise, un temps de grands changements sur les plans politique et social. D’abord, sur le plan politique, on voit l’émergence d’un pouvoir clérical fort important au Bas-Canada. De deux choses l’une, ce sont les insurrections patriotes des années 1837- 1838 qui seront en cause. Devant cet « échec » nationaliste d’indépendance, les patriotes s’exilent en laissant la gouvernance des institutions au clergé. De plus, la deuxième moitié du XIXe siècle est marquée par l’élan de l’ultramontanisme, mouvement tant spirituel (religieux) que temporel (politique). Monseigneur Ignace Bourget (1799-1885), deuxième évêque de Montréal, tente alors de démontrer la suprématie de l’Église sur l’État, et ce, en l’imposant dans différentes institutions.
Ainsi, sous l’influence ultramontaine, le clergé est partout : presse, charité publique, hôpitaux, émigration et colonisation ainsi que l’éducation. Ensuite, sur le plan social, la société dite d’Ancien Régime fait place à une société industrielle, caractérisée par la théorie des deux sphères : privée et publique. La sphère privée, ou sphère domestique, est réservée aux femmes alors que la sphère publique, aux hommes. Ainsi, les femmes sont réduites à demeurer dans la sphère privée. Micheline Dumont décrit cette période comme étant : « la mise en tutelle des femmes […] [elles] se voient reléguer (sic) spécifiquement à la vie familiale ». Somme toute, les événements du milieu du XIXe siècle assurent l’hégémonie religieuse, d’une part, et la réduction des femmes à la sphère domestique, d’une seconde part.
Entrer en religion, une avenue pour les femmes
Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, et ce, jusqu’aux années 1960, le nombre de religieuses augmente de façon inimaginable au Québec, passant [d’environ] 650 en 1850 à 13 579 en 1921, pour atteindre 43 274 en 1965, de sorte que le Québec devient la région du monde où l’on retrouve le plus de « religieuses pour 1000 femmes. ». La question peut bien se poser : pourquoi autant de femmes ont-elles voulu entrer en communauté religieuse ? La réponse évidente que toutes religieuses formuleraient serait la foi, recevoir l’appel de Dieu. Or, en remettant les événements dans leur contexte, on peut facilement penser que l’appel de Dieu s’est fait sentir différemment chez certaines religieuses : « Oui, certes au nom de Dieu. Mais également au nom d’une action à entreprendre dans le monde. » Effectivement, dans ce contexte des années 1840, où la femme était réduite au carcan de la sphère privée, nombreuses tentent d’y échapper.
À l’époque, seuls trois choix de vie étaient proposés aux femmes : le célibat, le mariage et la maternité ou la vie religieuse. Ce premier choix leur offrait une alternative afin d’éviter mariage et maternité. Cependant, à cette époque, et ce, jusque dans les années 1950-1960, les femmes célibataires étaient mal vues par la société. Le second choix de vie étant le mariage, les femmes, soumises à leur époux, voient succéder les nombreuses grossesses tout en étant privées de tous droits civiques. Ainsi, nombre de femmes voulant éviter mariage et maternité choisiront de prendre le voile. Nombre de religieuses se diront ne pas vouloir vivre la vie de leur mère.
De ce fait, en entrant au couvent, les : « femmes manifestaient leur refus du sort qui les attendait dans la vie laïque : sort qui se résumait soit à l’insécurité économique et au manque de considération sociale réservés aux célibataires, soit à l’incapacité juridique, aux maternités répétées et à l’enfermement domestique subis par les épouses. » À ce sujet, nous dit Dumont, les femmes démontrent : « une affirmation très forte […] une rupture décisive avec le statut d’humiliées ». La vie au couvent assurait aux femmes d’être nourries, logées et blanchies. Ces femmes avaient du même coup la possibilité d’être respectées et leur travail, formellement reconnu par la société.
De plus, la vie religieuse offre aux femmes une possibilité d’avancement social. En effet, alors qu’elles n’avaient accès à aucune profession, les sœurs, oui. Les communautés ont donc réussi à « attirer des jeunes filles aux caractères et aux aspirations variés ». Étant donné que les congrégations dirigeaient la santé, l’éducation et la charité publique, ces membres ont pu accéder à des positions prestigieuses, offrant « une avenue d’égalité avec les hommes puisqu’elle autorise l’exercice de fonctions interdites aux femmes dans la société ». Elles ont ainsi pu bénéficier de tâches de direction d’hôpital, d’enseignante aux études supérieures et aux études artistiques pour filles, gérer du personnel, diriger des fonds importants, etc.
D’ailleurs, on dénote qu’une religieuse sur six a réussi à atteindre des fonctions de responsable au sein de sa communauté. Somme toute, cette vocation a offert aux différentes femmes la possibilité de sortir de la sphère privée, d’éviter la maternité, de s’éduquer, de se faire reconnaître dans la société. Bref, grâce à la profession religieuse, de nombreuses femmes ont pu s’épanouir dans leur travail.
Un vent de changement
La seconde moitié du XXe siècle est caractérisée par une conjoncture dite de libération religieuse. Durant les années 1960, l’Église qui jusqu’alors possédait énormément de pouvoir est écartée et réduite à titre de bailleur de fonds. D’abord, ladite Révolution tranquille semble une période voulant tourner le dos à la quinzaine années de conservatisme duplessiste. Elle marque un tournant majeur dans l’histoire québécoise. Bien que l’histoire ne se fasse pas à coup de rupture, on constate de nombreux changements auprès de l’Église à cette époque. Ladite révolution est caractérisée par l’État-providence. De deux choses l’une, l’État intervient massivement dans les institutions québécoises : éducation, santé et services sociaux, où l’on crée des ministères. Ceux-ci engagent massivement des employés de la fonction publique qui remplacent les « bonnes sœurs ».
Ces religieuses qui possédaient des fonctions importantes sont écartées au profit d’hommes et de femmes laïques issus de la fonction publique. Par la suite, les événements entourant la réforme cléricale de Vatican II (1962-1965) amènent l’Église à adopter de nouvelles règles moins rigides. On y dénote une véritable diminution de religieuses. Finalement, les années 1960 sont caractérisées par l’émancipation de la femme et la libéralisation des mœurs de cette époque. Plus précisément, on connaît une amélioration de la condition des femmes : le divorce et la pilule contraceptive sont « légalisés ». Les femmes laïques ont un plus grand accès au marché du travail et aux études supérieures, le nombre d’enfants par femme diminue, la pratique religieuse s’affaiblit et le mouvement féministe s’accentue ! Enfin, le contexte sociopolitique des années 1960 au Québec marginalise l’Église et ses institutions, la rétrogradant en tant que bailleur de fonds.

Sœur Jeannette Berger ( Sœur Sainte-Jeanne-Marie, s.s.ch.) 1 9 6 2 [ Auteur inconnu] © Fonds d’archives Aurore Desautels – Olivier Berger
L’absence de relève
La situation québécoise de cette époque amène une importante réduction des effectifs chez les religieuses. « Non seulement on entre moins en communauté, mais on sort davantage. » Certainement, durant les années 1960 et 1970, le nombre de jeunes filles qui prennent le voile est en chute et, même, certaines religieuses quittent la vie religieuse. À ce sujet, nous dit Dumont, on voit une : « baisse effective des vocations […] de 30 % entre 1960 et 1964 ». Et elle ajoute qu’entre 1968 et 1972, ce sont dix religieuses qui quittent leur congrégation par semaine. Cette chute des effectifs se traduirait par deux éléments : la perception de la religion ainsi que les choix de vie offerts aux femmes. Premièrement, après avoir été tentaculaire dans les années sous le régime de Duplessis, l’Église est désertée par bon nombre de fidèles.
L’opinion publique face au clergé change également : la profession religieuse n’est désormais plus valorisée au sein de la société québécoise. « [La vocation à la vie religieuse n’étant plus une avenue privilégiée de réalisation personnelle, elle aurait été abandonnée par un grand nombre de femmes qui l’avaient choisie. » D’ailleurs, parmi les 16 raisons évoquées par Jacqueline Bouchard dans son étude traitant de la sortie des religieuses de leur communauté, trois sont en lien direct avec cette situation : « le statut social diminué des religieuses », « la déception devant l’idéal religieux » et « les lacunes dans l’exercice de l’autorité religieuse ». On remarque alors que la vie religieuse est fortement dévalorisée, ce qui influe sur le nombre de postulantes et sur la quantité de sœurs qui quittent leur congrégation… »

Groupe d’élèves au couvent de Saint-Étienne-de-Bolton, vers 1960 [Auteur inconnu] © Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton
Deuxièmement, avec l’émancipation des femmes pendant les années 1960, plus besoin d’entrer dans les ordres religieux pour s’épanouir. Avec la montée du féminisme et des revendications qui y sont rattachées, les femmes ne sont plus soumises à la sphère privée comme jadis. Elles ont par conséquent la possibilité de faire partie de la sphère publique au même titre que les hommes. Cela leur offre la possibilité en tant que laïque de bénéficier d’un statut et d’une éducation.
Ainsi, la vie laïque leur offre une variété de possibilités d’emplois et de conditions de vie qui leur étaient jadis impossibles d’accès sans entrer dans les ordres religieux. Effectivement, elles peuvent désormais accéder au marché du travail et aux études supérieures, et ce, sans avoir nécessairement à prendre le voile. On assiste d’ailleurs à une véritable substitution des tâches autrefois occupées par les religieuses, maintenant accordées à des laïques : enseignantes, infirmières, voire préposées aux bénéficiaires, etc. De plus, avec la « légalisation » du divorce et de la pilule contraceptive, les femmes possèdent dorénavant « le plein pouvoir » sur leur vie et leur corps. Elles peuvent librement choisir d’adhérer ou non au mariage et contrôler leurs natalités. Il n’est certes plus nécessaire d’entrer au couvent pour éviter ces situations.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, on peut affirmer que la tendance à entrer chez les religieuses se voit être une réponse aux aléas de la condition féminine. Effectivement, lorsque les femmes perdent leurs bonnes conditions sociales, principalement au XIXe siècle, on dénote une forte croissance des postulantes dans les congrégations religieuses. Or, dès que leur situation s’améliore, ce nombre chute drastiquement. Il serait cependant faux et loin de notre volonté d’affirmer que les femmes étant entrées en communauté aient été opportunistes. Selon nous, elles ont cependant voulu lutter contre la société pour s’émanciper et c’est par le biais de la vie en communauté qu’elles ont pu y arriver. On peut donc fortement penser que les religieuses ayant choisi d’entrer en communauté, suivant l’appel de Dieu, y sont restées à la suite de « la grande hémorragie » , alors que celles qui y sont entrées pour des raisons matérielles et professionnelles (éviter mariage et maternité ainsi que jouir d’un statut) ont quitté la vocation à la vie religieuse lorsque la condition féminine leur a été plutôt favorable.
Médiagraphie
CARRIER, Marie-Paule. « La vocation religieuse », Université de Sherbrooke, 4 février 2019.
DUMONT, Micheline. « Les femmes et la vocation religieuse », dans Les religieuses sont-elles féministes ?, Montréal, 1995, p. 23-62.
FERRETTI, Lucia et BOURASSA, Chantal. « L’éclosion de la vocation religieuse chez les sœurs dominicaines de Trois-Rivières : pour un complément aux perspectives de l’historiographie récente », 2003, p. 29.
LACHAPELLE, Lucie. Femmes et religieuses. 1999.
BIENVENUE, Louise et LAPERRIÈRE, Guy. « Sans elles, le collège ne serait pas ce qu’il est ». Le travail des Petites Sœurs de la Sainte-Famille dans les collèges classiques au Québec » ». Histoire sociale/Social History, n° 47, 2014, p. 5-35.
PROULX, Jean-Pierre. « Il y a 50 ans : Vatican II — Le concile qui a bouleversé l’Église ». Le Devoir. 22 janvier 2012, (Consulté le 12 février 2019).
Société histoire et patrimoine de Saint-Étienne-de-Bolton, 2019.
*****
Cliquez ici pour retourner à la page d’accueil du site pour lire ou relire d’autres articles.
__________
L’Entraide numérique est un site Web de publication d’articles publié par la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est (SGCE) ayant pour objectif le partage des connaissances de nos membres. Il se veut un complément à notre revue L’Entraide généalogique. Ce site Web publie trois fois par semaine, soit les lundis, mercredis et vendredis, sur des sujets liés à la généalogie, à l’histoire ou au patrimoine québécois. Le site est ouvert à tous, membres et non-membres de la SGCE. On peut s’y abonner sur la page d’accueil du site et ainsi recevoir une infolettre qui vous envoie l’intégralité de chaque article dès sa publication.


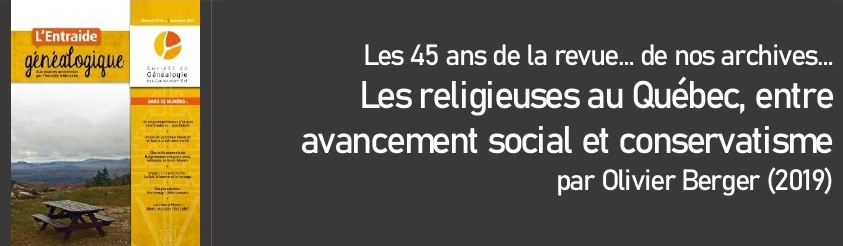



Laisser un commentaire