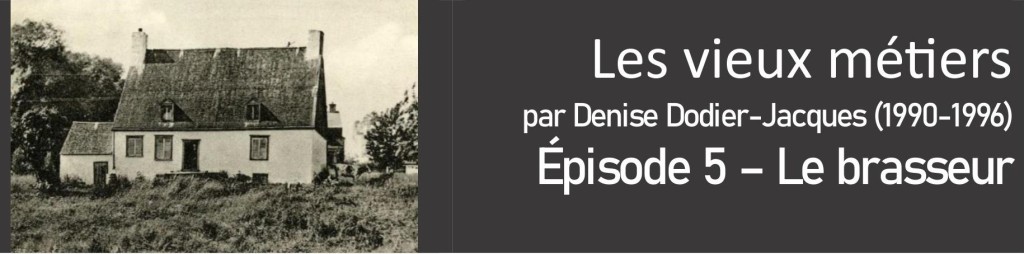Madame Denise Dodier-Jacques avait écrit dans L’Entraide généalogique une série d’articles connue sous le nom Les Vieux Métiers. Cette série a été publiée il y a une trentaine d’années, en 20 épisodes échelonnés entre 1990 et 1996. Peu d’entre nous se rappellent donc de cette série qui a marqué. Pas moins de quatre de ces articles s’étaient mérités le prix Raymond-Lambert du meilleur article de l’année.
Nous avons retracé les 20 épisodes en question qui vous seront présentés graduellement au fil des prochains mois. Ce cinquième article intitulé Le Brasseur a été publié il y a près de 30 ans, soit à la fin de 1996. Il reflète donc l’état des choses à cette époque.

Madame Denise Dodier-Jacques (photo de la revue L’Entraide généalogique 1996 no. 19-4).
Temps de lecture estimé – 16 minutes
Cliquez ici pour retourner aux épisodes antérieurs liés à cette série d’articles.
*****
LE BRASSEUR
Un peu d’histoire
Celui de nos lointains ancêtres, capable, plus qu’un autre, de réussir une savoureuse bière d’orge, voire une bière de froment, était un brasseur; et sans nul doute qu’un de ces riches pharaons, princes ou commerçants voulut l’attacher à son service. Ainsi dut naître le métier.
Le brassage de la bière n’est pas une invention récente. En effet nous savons que la bière était connue dès l’antiquité égyptienne, grecque, romaine, gauloise et germanique. Cependant elle différait de notre liqueur actuelle. En France, la cervoise se servait sans houblon; on commença à en ajouter au 16e siècle. La bière était la boisson favorite des Germains et des Saxons depuis les temps anciens, elle fut adoptée par les autres pays lors des invasions germaniques. Les Allemands préfèrent encore la bière, mais elle est aussi très populaire chez les Belges, les Hollandais, les Anglais, les Américains, en un mot partout où la culture de la vigne est peu prospère.
Vers l’an 565 av. J.-C., les brasseurs étaient groupés en corporation et jouissaient d’une haute considération. La corporation comprenait, sans doute, des apprentis brasseurs, des maîtres brasseurs, des grands maîtres brasseurs.
Au VIIe siècle, en Angleterre, la bière était soumise à certaines lois. En 1516, Guillaume IV de Bavière promulguait sa «loi de la pureté», réglementant le brassage. Le but était de sauvegarder la parfaite originalité du breuvage et d’écarter tout danger de falsification.
Avant l’arrivée des premiers Blancs en Amérique du Nord, les Amérindiens brassaient déjà leur propre bière, obtenue en laissant fermenter du maïs dans de l’eau.
Dès les premières années de la colonie, des habitants fabriquent aussi leur bière. En 1647, les pères jésuites construisent une brasserie pour répondre aux besoins de la communauté. L’intendant Talon en 1668, décide de construire une brasserie pour les besoins de la population. En mars de la même année, le Conseil souverain émet une ordonnance restreignant la consommation d’alcool et de vin, mais favorisant la fabrication de la bière. Il établit le monopole de fabrication de la bière, mais maintient pour les individus la permission de continuer le brassage artisanal pour leur usage personnel et l’usage de leurs domestiques. Le prix de vente de la bière, « boisson nourrissante et saine», est de 20 livres pour une barrique de bière en gros, «le fût non compris». La production annuelle de la brasserie de l’intendant Talon est de 4000 barriques. De petites brasseries sont exploitées à Montréal, Trois-Rivières et Québec. Plus tard en 1786, une brasserie (existant encore), offrait un choix de «4 étiquettes» à sa clientèle: la Bière forte (Strong Ale), la Bière douce (Mild Ale), la Bière de table (Table Beer) et la Petite bière (Small Beer). Et plus près de nous, en Estrie, des brasseries sont établies en 1825 à Hatley, en 1859 à Sherbrooke. En 1880, le marché des bières s’élargit, suite à la croissance des villes.
La consommation de boissons alcooliques existe depuis les temps les plus anciens et nous connaissons les effets négatifs sur certains buveurs. Pour remédier à cela, les mouvements de tempérance luttent contre la vente de l’alcool et font pression sur les gouvernements. C’est un succès et le gouvernement du Québec emboîte le pas.
Une loi de la prohibition est adoptée, sous Gouin, en février 1918, pour combattre la vente de l’alcool. Les autorités n’ont pas sérieusement veillé à son application et comme la fraude et la contrebande se pratiquaient sur une grande échelle, le Trésor perdait des recettes. C’est alors que le ministre avance l’idée d’une régie des spiritueux. «À l’origine, le projet comprend non seulement la vente des vins et des spiritueux mais aussi celle de la bière, ce qui soulève les protestations des chefs syndicaux. Le gouvernement abandonne alors l’idée d’étatiser la vente de la bière». (1) Le gouvernement prend le contrôle de la vente d’alcool. Il sanctionne le 25 février 1921, la loi établissant la régie des alcools et crée une commission des liqueurs. La vente de la bière demeure entre les mains des puissantes et influentes brasseries.
La fabrication de la bière
Le brasseur pratiquait son métier d’instinct en utilisant des recettes anciennes transmises, par son prédécesseur, pendant son apprentissage. La connaissance des ingrédients nécessaires à la fabrication de la bière ne suffit pas. Le brasseur doit connaître l’importance et le rôle respectif de chacun des ingrédients. De plus, il doit savoir dans quel ordre ils interviennent, quelles sont les transformations qu’ils subissent et au cours de quelles opérations. Il pèse les ingrédients nécessaires sur des balances, à l’œil pour chaque brassin, et surveille les températures des mélanges et la pression à l’œil également. Les transferts de liquide se font manuellement. L’odorat et le goût du brasseur guident son instinct, et c’est grâce à eux qu’il peut produire une bonne bière.
L’arrivée de la mécanisation dans les brasseries a facilité le travail des brasseurs, et maintenant tout est automatique, tout le contrôle se faisant depuis un écran cathodique.
La bière est une boisson fermentée, préparée surtout à partir de l’orge et du houblon. Elle est rafraîchissante et stimulante, mais sa consommation quotidienne peut conduire à l’alcoolisme. C’est un produit apprécié à travers le monde depuis des millénaires. Il y a trois types de bière: légère ou pâle, forte, et très forte ou porter, selon le dosage qu’elle contient; cette teneur en alcool varie de 2 à 13.2% suivant le maltage employé, les procédés de fabrication et le degré de fermentation. Si le vin a ses bordeaux, bourgognes et champagnes qui se subdivisent en plusieurs clos et cépages, la bière est disponible en une très grande variété qui se distingue par les proportions et les procédés et, plus rarement par les ingrédients.
Pour la fabrication de la bière le brasseur emploie quelques ingrédients qui sont limités en nombre, et ils changent peu. Une matière qui se transforme en alcool: du grain (généralement de l’orge mais parfois du froment, du maïs, du riz, du seigle, du manioc, des patates douces, du sorgho), de l’eau, de la levure et des aromates (presque toujours du houblon). Le houblon donne plus de saveur et de limpidité. C’est lui qui donne à la bière son goût plus ou moins piquant, son degré d’amertume.
La couleur de la bière dépend de la nuance et du temps d’ébullition du malt. Sa qualité provient des matières premières employées et de leur quantité proportionnelle dans la préparation du malt; de la température sous laquelle s’opère la fermentation, et de la durée de la fabrication.
«Comme le pain, la bière est un simple mélange de grain, de levure et d’eau. On a longtemps utilisé les phénomènes chimiques qui permettent sa fabrication sans vraiment les comprendre. Et comme le pain, la bière constitue un des aliments les plus anciens et les plus répandus au monde. » (2)
Pour fabriquer la bière, il y a trois opérations qui sont nécessaires: le maltage, le brassage et la fermentation. Le maltage rend soluble l’amidon présent dans l’orge, ce qui est nécessaire au processus du brassage. Le maltage est une germinaison contrôlée, qu’on obtient en immergeant l’orge dans l’eau pendant quelques jours. Le malt ainsi obtenu est nettoyé et moulu, puis versé dans «la cuve matière» et mélangé à de l’eau chaude, en proportions telles que le résultat a une consistance ressemblant à du gruau: le brassin. On le tient à une température contrôlée, pendant quelques heures, puis on le filtre. Le liquide qui en résulte est le moût, qui sert de point de départ à la fabrication de la bière. Le brasseur introduit le moût dans la cuve de brassage et le porte à ébullition. La durée de cette opération varie selon le type de bière. L’intensité de l’ébullition est aussi contrôlée rigoureusement. C’est à cette étape qu’on ajoute le houblon au moût. Le type de houblon utilisé, sa quantité et même le moment de son addition au moût contribuent à donner à une bière son caractère propre.
Après le brassage, le liquide refroidi est transféré dans la cuve de fermentation, où on lui ajoute la levure selon la bière désirée. C’est la fermentation qui produit l’alcool de la bière. Une partie de la levure est éliminée et la bière refroidit rapidement, presque au point de congélation. Elle continue lentement sa fermentation et commence sa maturation. Lorsque le liquide est stabilisé et la fermentation terminée, il est filtré et transféré dans les cuves de garde à des températures froides et contrôlées. Après une nouvelle filtration, la bière est conduite dans les cuves d’attente et de là vers l’embouteillage, la mise en canettes ou en fûts. La bière embouteillée ou mise en canettes est pasteurisée pour une plus grande stabilité biologique, ce qui prolonge sa fraîcheur. Quant à la bière en fût, elle ne l’est pas. L’opération serait inutile car son espérance de vie n’est pas très longue.
Les opérations pour la fabrication domestique, artisanale ou industrielle de la bière sont similaires. Le brasseur peut se procurer de l’extrait de malt (orge malté commercialisée) qu’il fait ramollir dans l’eau chaude. Le liquide qui en résulte est le moût dont il se servira.
Le matériel du brasseur de bière domestique se compose de cuves, tasses à mesurer, cuillères, thermomètre, densimètre, d’un siphon pour le soutirage de la bière, d’un tube en «J», d’une tourie stérilisée. Celui des brasseries comprend: des cuves, pour le brassage, pour la fermentation, pour l’attente, pour le brassin. Ils utilisent également des réfrigérateurs, des barils, des fûts, des réservoirs, des pompes, des filtreurs, des densimètres, des stérilisateurs, des hydromètres, des silos à malt, des thermomètres. À propos de thermomètre, son «utilisation remonterait à la fin du XVIIIe siècle. Auparavant, les brasseurs plongeaient leur coude dans le bassin pour en apprécier la température. »(3) Il ne faut pas oublier l’appareil à capsuler les bouteilles (capsulateur) ainsi que les bouteilles! Dès 1800, une brasserie de Montréal employait des bouteilles pour la commercialisation de sa bière.
La bière d’aujourd’hui
La bière est fabriquée en grande quantité. On en exporte dans plusieurs pays: États-Unis, Antilles, Japon, Grande-Bretagne et autres. Les amateurs peuvent trouver sur le marché bien des sortes de bières d’importation.
La bière donne lieu à des réjouissances: on n’a qu’à penser à l’Octoberfest de Munich, au carnaval des Trois Jours gras, le Fasching de Cologne, à nos fêtes populaires. Dans certaines régions, comme en Bavière, la bière a la même valeur culturelle que le vin en France. Elle est devenue le symbole d’une façon de vivre. Le monde change. La bière est sortie des tavernes et précède volontiers le repas dans un restaurant chic.
Nous retrouvons aussi la bière en cuisine. Elle entre dans la préparation de certains mets: soupe à la bière et aux concombres, jambon à la bière, cake à la bière, crêpes à la bière, beignets à la bière et aux pommes, punch à la bière.
Il existe des recettes pour la fabrication de la bière domestique et artisanale qui semblent faciles à réussir. L’amateur intéressé peut se procurer le moût concentré, les autres ingrédients et le matériel nécessaire à la fabrication et à l’embouteillage dans les boutiques spécialisées à cet effet. Il trouvera aussi sur place, des conseillers expérimentés.
Le métier de brasseur est devenu moins physique mais plus technique qu’auparavant. L’art brassicole ne se perd pas. Cependant l’amélioration des connaissances a réduit l’aspect artisanal et instinctif du brassage de bière. Brassée à l’échelle industrielle, elle est meilleure que la bière artisanale d’antan et plus uniforme. L’amateur de bière sait toujours à quoi s’attendre bouteille après bouteille. Les quantités, les températures, le synchronisme des opérations, la durée des étapes, tout ça est contrôlé par ordinateur.
La fabrication domestique et artisanale de la bière a toujours sa place. Le brasseur peut personnaliser la bière de sa propre fabrication. Fabriquer de la bière n’est pas sorcier mais «en réussir une bonne» demande de l’art…
«À la bonne vôtre!»
Bibliographie:
1- Lacoursière, J., Provencher, J., Vaugeois, D., Canada-Québec synthèse historique, Éd. Renouveau Pédagogique Inc. Montréal 1978, p. 500.
2- «Cahier spécial Molson, 1786-1986», La Tribune, Sherbrooke, 7 juin 1986, 36 p.
3- Ibidem.
Voir aussi :
– Encyclopédie Grolier, tome II, La Société Grolier ltée, 1954, p. 211-212.
– Girard, Sylvie, Guide de la bière et ses à-côtés, Éd. Messidor/ Temps-Actuels. 1983.
– Nos racines, l’histoire vivante des Québécois, un pays à bâtir. Vol. II Éd. T.L.M., p. 199
– «La tradition du brassage de la bière passe par l’Estrie», La Tribune, Sherbrooke. 6 février 1990. p. C7.
– Articles de journaux publiés dans «Perspectives», La Tribune, Sherbrooke.
*****
Cliquez ici pour retourner aux épisodes antérieurs liés à cette série d’articles.
Cliquez ici pour retourner à la page d’accueil du site pour lire ou relire d’autres articles.
__________
L’Entraide numérique est un site Web de publication d’articles publié par la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est (SGCE) ayant pour objectif le partage des connaissances de nos membres. Il se veut un complément à notre revue L’Entraide généalogique. Ce site Web publie trois fois par semaine, soit les lundis, mercredis et vendredis, sur des sujets liés à la généalogie, à l’histoire ou au patrimoine québécois. Le site est ouvert à tous, membres et non-membres de la SGCE. On peut s’y abonner sur la page d’accueil du site et ainsi recevoir une infolettre qui vous envoie l’intégralité de chaque article dès sa publication.