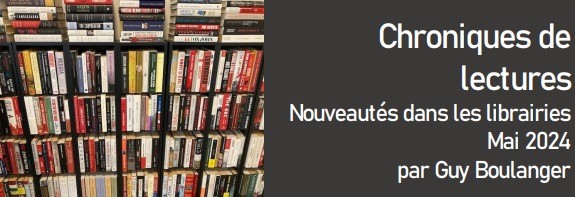De façon régulière, nous surveillons pour vous les récentes parutions dans les librairies à travers cette chronique qui revient au moins une fois par mois et qui se donne comme mandat de couvrir nos domaines prioritaires: la généalogie, l’histoire et le patrimoine, avec un focus sur le Québec en général.
Pour cette chronique de mai, une sélection variée de cinq nouveaux bouquins a retenu notre attention. Avec la saison estivate qui arrive, nous ferons plus léger qu’à l’habitude avec même quelques romans historiques.
Tous les livres dont nous parlons sont disponibles en librairie, y compris sur le site Web de ces libraires ou chez les éditeurs, pour livraison à domicile ou en succursale. Basé sur notre expérience des chroniques précédentes, ils sont également rapidement disponibles à la bibliothèque de la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est ou encore à la bibliothèque Éva-Senécal de la Ville de Sherbrooke. En vous renseignant auprès de ces institutions ou encore auprès de votre propre bibliothèque municipale, vous pourrez y réserver et emprunter votre copie si c’est votre préférence.
Cliquez ici pour lire ou relire nos chroniques de lectures des derniers mois.
Temps de lecture estimé – 17 minutes
*****
POUR EN FINIR AVEC DOLLARD
Notre première suggestion a été publiée au début du mois d’avril chez les Éditions Boréal. Il s’attaque au mythe de Dollard des Ormeaux qui aura vécu au début de la Nouvelle-France. Son parcours est étroitement lié à nos relations avec les autochtones de l’époque.
Ce bouquin est écrit par Patrice Groulx, un historien qui avait également publié récemment – en 2020 chez le même éditeur – une autre biographie, celle de François-Xavier Garneau.
C’est d’ailleurs cette fin de semaine-ci que l’on célèbre la traditionnelle fête de Dollard qui avait été instituée durant les années 1920. Elle compétitionnait au même moment avec la fête de la Reine – Victoria – davantage célébrée au Canada anglais. Plus récemment au début des années 2000, la fête des Patriotes ou la Journée nationale des Patriotes la remplace, reléguant Dollard des Ormeaux plus ou moins dans l’oubli.
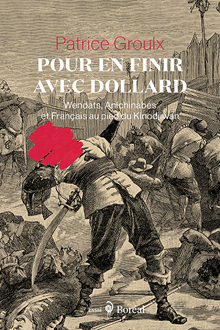
Quatrième de couverture : Le mythe de Dollard des Ormeaux brouille depuis longtemps la mémoire des relations entre Autochtones et allochtones. La légende est simple en apparence : en mai 1660, dix-sept Français commandés par Dollard des Ormeaux auraient entraîné quarante Wendats et quatre Anichinabés dans une expédition sur la rivière des Outaouais pour piéger les Haudénosaunés, leurs ennemis. Les alliés auraient été massacrés à la suite de la trahison de plusieurs Wendats. Dans un glorieux acte de bravoure, Dollard aurait sacrifié sa vie pour sauver la jeune colonie de Montréal.
L’événement tombe dans l’oubli jusqu’à son rappel au XIXe siècle par les historiens. Culminant dans les années 1910-1920, la célébration de Dollard se matérialise dans une fête chômée, des écrits, des œuvres d’art. Parallèlement, les alliés autochtones sont de plus en plus exclus de ces récits.
Alors qu’aujourd’hui on conteste les vestiges de la célébration de Dollard et qu’on songe même à déboulonner les monuments élevés à sa gloire, une relecture détaillée de la bataille, des motivations de ses acteurs et de sa mémoire s’impose. Ce livre nous invite à mettre fin à une injustice criante en réexaminant l’événement grâce à une critique plus poussée des sources – lesquelles ont notamment reproduit textuellement la parole, l’expérience et la culture des Wendats chrétiens réfugiés à Québec.
À L’ORÉE DE LA FRONTIÈRE
Nous avons pris l’habitude depuis quelques mois d’inclure des romans historiques dans nos suggestions mensuelles. Hésitant à le faire au début, j’ai testé l’intérêt et il s’avère qu’elles sont bien reçues et qu’il y a un public pour ce genre littéraire parmi nos lecteurs. Cette seule chronique en contient d’ailleurs trois.
Cette parution d’il y a quelques semaines nous envoie dans la Beauce de l’entre-deux guerres aux environs de 1925 dans cette région frontalière entre le Québec et l’État américain du Maine, une région rarement mise de l’avant dans nos romans historiques. Écrit par Esther Gagné, il semble qu’il s’agisse de son premier roman. Il vous est livré sur près de 400 pages pour les lecteurs qui s’intéressent aussi à ce critère pour pré-sélectionner leurs lectures à venir.
Laissons parler la quatrième de couverture pour vous donner une bonne idée du voyage qui vous attend en vous lançant dans la lecture de ce bouquin.
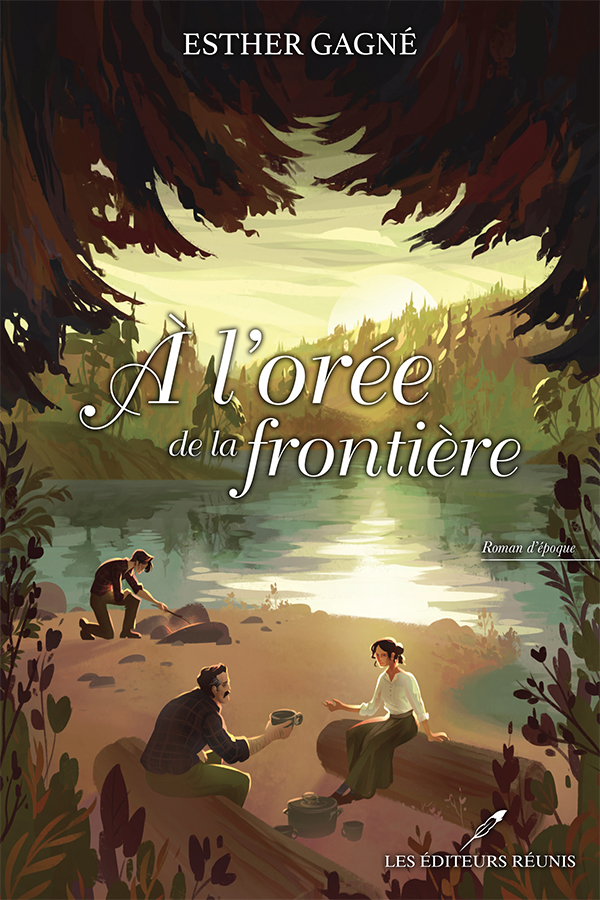
Quatrième de couverture: Beauce, 1925. Adélia Tessier, vingt-cinq ans, s’installe à Saint-Théophile, un village à la croisée des chemins entre la Beauce et le Maine. Grâce à ses talents de sage-femme et de soignante, elle réussit à se tailler peu à peu une place dans la communauté, où elle vit très modestement et en solitaire – c’est le prix qu’elle accepte de payer pour son indépendance.
Au cœur des liens qui se tissent dans cette zone frontalière, elle doit composer avec Achille Fortier qui, sous le couvert d’une compagnie de transport, fait de la contrebande d’alcool vers les États-Unis. Généreux, Achille aide les paroissiens, allant même jusqu’à payer Adélia pour les soins qu’elle leur prodigue. Un nouveau curé, l’abbé Provost, arrive dans la région, avec pour mission de remettre dans le droit chemin ceux qui trempent dans les activités illicites. N’ayant pas pris mari, la jeune femme est aussi dans sa mire.
Sa vie prend un nouveau tournant lorsqu’elle rencontre Daniel, un guide de chasse et de pêche d’un peuple autochtone du Maine, avec qui elle se lie dans le secret. Pendant ce temps, le commerce d’Achille périclite et les contrebandiers sèment le désordre.
Adélia trouvera-t-elle le courage de suivre son cœur en dépit des forces qui s’opposent autour d’elle?
TERRE DE NOS AÏEULES
Pendant que l’on y est, voici un deuxième roman historique en ce début de printemps, qui dans mon cas du moins est la période – avec l’été – où je lis surtout des romans, souvent historiques mais pas seulement québécois.
Celui-ci s’intitule Terre de nos aïeules, sous la plume de Nicole Lussier, et est publié aux Éditions Saint-Jean. Il devrait intéresser plusieurs d’entre vous de par son sujet. L’histoire se situe aux débuts de la Nouvelle-France, avec les Filles du Roy comme toile de fond.
C’est une histoire personnelle de ses ancêtres que Nicole Lussier nous livre sur près de 500 pages. C’est d’ailleurs l’une des nôtres puisqu’elle est née et a passé toute sa vie dans les Cantons-de-l’Est. Elle se dit passionnée de généalogie et d’histoire de la Nouvelle-France.
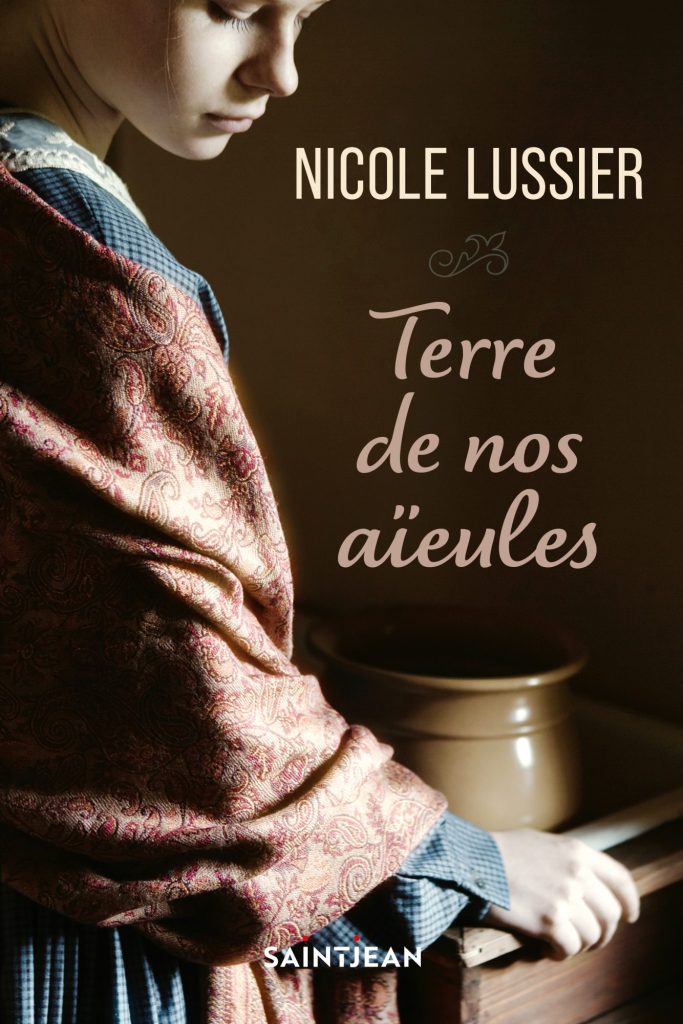
Quatrième de couverture: Un récit historique époustouflant marqué par la résilience et les moments de grâce.
Lorsqu’en 1666, à tout juste vingt ans, Jacques Lussier quitte Paris pour vivre la grande aventure de la Nouvelle-France, il ne se doute pas des conséquences de son geste.
Le rêve de bâtir un nouveau monde s’impose par sa noblesse, mais nul ne connaît réellement les défis qui l’accompagnent… Après avoir complété ses trente-six mois de service, il s’établit comme colon à Varennes, auprès de son mentor, Pierre Boucher de Boucherville. Le cœur plein d’espoir, prêt à fonder une famille, il se prépare à accueillir le prochain contingent de Filles du Roy.
Catherine Clérice, abandonnée par sa mère au couvent des Filles de la Charité, embarque à La Rochelle, en 1671, avec ses compagnes de la Salpêtrière, Jeanne, Isabelle et Sarah, pour un voyage jugé incomparable par Louis XIV… Les destins de ces deux humains exceptionnels seront unis à tout jamais.
À travers embûches et drames, ce roman lumineux nous plonge au cœur de la vie de ces familles bâtisseuses de colonies.
LA TERRE MATERNELLE
Un troisième roman historique est peut-être de trop pour une seule chronique mais j’imagine que la plupart des lecteurs assidus recherchent probablement davantage de légèreté pendant les mois chauds de l’été.
Celui-ci est un peu différent et vient de sortir aux Éditions XYZ. Écrit par Anne-Marie Turcotte, il s’intitule La Terre maternelle.
Un récent commentaire d’une libraire (Geneviève, libraire à la Librairie-Boutique Vénus), publié sur le site de l’éditeur, mentionne :
Mariant l’autofiction, le roman historique et la légende québécoise, le roman d’Anne-Marie Turcotte offre une lecture remplie de belles surprises. […] Je suis encore habitée par tout l’amour qu’Anne porte au territoire et par sa façon de nous transmettre son amour de la culture québécoise et de la langue française. Elle livre un plaidoyer sincère à la nature, à sa région et à ceux et surtout celles qui l’ont bâtie et vue grandir.
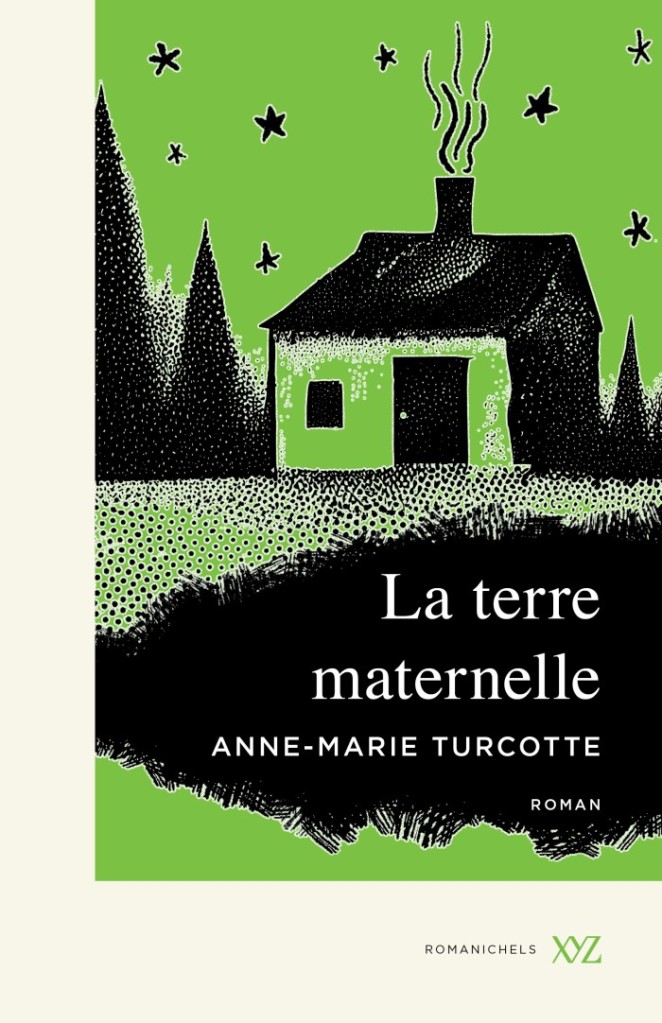
Quatrième de couverture: Quand on grandit dans un village où la rivière ne gèle pas, la résistance de tout un peuple de Filles du Roy et de Draveurs nous coule dans les veines. On apprend à conduire sur le chemin de l’Arc-en-Ciel et on baptise son char dans la Colonie. On sait que les meilleures talles de bleuets se trouvent sur la route du Chômage. On connait les anciennes cachettes d’un célèbre contrebandier dans le Brise-Culotte. On tombe en amour sur la montagne du Fourneau. On hérite de la fertilité légendaire des femmes qui ont tapé une trail vers la revanche des berceaux.
LE MANUSCRIT DE JEAN-BAPTISTE MINET
Après l’aventurier Dollard des Ormeaux du début de cette chronique, terminons-la avec cet autre héros des débuts de la colonie, Cavelier de La Salle, avec ce bouquin intitulé Le Manuscrit de Jean-Baptiste Minet. Jean-Baptiste Minet était un ingénieur qui avait accompagné De La Salle dans ses expéditions.
Dès les premières phrases du récit de plus de 500 pages, on est tout de suite guidé sur ce qui nous attend :
La Rochelle, juin 1684. Le port et la ville débordent d’activité. Plusieurs vaisseaux s’apprêtent à partir pour les Îles et pour le Canada. Cavelier de La Salle a donné rendez-vous à ceux qui doivent l’accompagner dans une nouvelle aventure. Cette fois, la destination n’est pas Québec, mais le golfe du Mexique, où l’explorateur va fonder une colonie, avec l’approbation du roi Louis XIV. Pour cette expédition, il fait équiper et charger quatre vaisseaux : l’Aimable, la Belle, le Joly, le Saint-François. Mais tout cela coûte cher et La Salle s’active ailleurs pour trouver des fonds, d’où son retard à rejoindre ses gens à La Rochelle. L’attendent ainsi plus d’un mois les capitaines et les équipages des vaisseaux, les officiers et les soldats recrutés, des prêtres et des missionnaires, les représentants du roi, des artisans, deux familles de colons, des recrues de toutes sortes et un jeune ingénieur militaire de 23 ans, Jean-Baptiste Minet, qui tiendra un journal de son voyage avec l’explorateur.
Le bouquin est publié aux Éditions PUL (Presses de l’Université Laval) et est écrit par trois auteurs qui commenteront ce récit. Ces auteurs sont Danielle Trudeau, Louise Trudeau et André Sévigny, tous trois spécialisés dans des sphères complémentaires en histoire.

Quatrième de couverture : Le manuscrit de Jean-Baptiste Minet a été rédigé en 1684-1685 par ce jeune ingénieur qui raconte les explorations de René-Robert Cavelier de La Salle en Nouvelle-France et sa dernière expédition au golfe du Mexique. À travers l’œuvre se manifestent, outre la fraîcheur du regard, l’étonnante précision de l’auteur, son œil perçant et sa démarche investie qui, au fil des pages, nous amènent à réviser l’image héroïque de La Salle et à accorder davantage de crédit à ses compagnons d’aventure.
L’édition critique de ces pages fascinantes présente le texte intégral français et, en regard, la version modernisée. Grâce à l’analyse exhaustive de l’ouvrage, sur les plans historique, géographique et linguistique, nous livrons au lecteur un document méconnu, voire négligé de l’histoire. Pour des raisons politiques, le manuscrit de Jean-Baptiste Minet est demeuré secret en son temps. Des connaisseurs l’ont préservé durant les siècles suivants. L’édition critique intégrale proposée maintenant lui redonne sa place parmi les précieux documents de l’histoire coloniale française en Amérique.
*****
Cliquez ici pour lire ou relire nos chroniques de lectures des derniers mois.
Cliquez ici pour retourner à la page d’accueil du site pour lire ou relire d’autres articles.
__________
L’Entraide numérique est un site Web de publication d’articles publié par la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est (SGCE) ayant pour objectif le partage des connaissances de nos membres. Il se veut un complément à notre revue L’Entraide généalogique. Ce site Web publie trois fois par semaine, soit les lundis, mercredis et vendredis, sur des sujets liés à la généalogie, à l’histoire ou au patrimoine québécois. Le site est ouvert à tous, membres et non-membres de la SGCE. On peut s’y abonner sur la page d’accueil du site et ainsi recevoir une infolettre qui vous envoie l’intégralité de chaque article dès sa publication.